Capital: Les immigrés italiens, polonais ou asiatiques, ont toujours réussi à s’assimiler dans notre pays. Avec les étrangers venus d’Afrique du nord, en revanche, le processus d’intégration fonctionne beaucoup moins bien. Comment peut-on expliquer cela ?
Philippe d’Iribarne : Il faut nuancer cette affirmation. Une bonne partie des immigrés et des enfants d’immigrés du Maghreb trouvent leur place dans notre société. Ils ont un emploi, une famille, acceptent nos valeurs, adoptent nos codes sociaux. Certains réussissent même très bien, tout comme nombre de ceux qui viennent de leur pays d’origine : chaque année, par exemple, une vingtaine d’étudiants marocains sont reçus à polytechnique ! Cela dit, il faut reconnaître que beaucoup d’autres peinent à s’intégrer. Le taux de chômage très élevé auquel cette population est confrontée, sa surreprésentation dans les prisons et l’émergence, dans les cités, d’une contresociété assise sur le fondamentalisme islamique en sont des indices inquiétants.
Capital : Les travailleurs que l’on était allé chercher en Algérie et au Maroc il y a un demi-siècle semblaient pourtant bien engagés sur la route de l’intégration…
Philippe d’Iribarne : Oui, mais avec leurs enfants, le processus s’est enrayé, c’est cela qui fait question. Pour les Italiens, les Portugais, les Polonais et d’autres, la seconde génération s’en sortait mieux que la première. Ce n’est plus le cas.
Capital : Selon vous, à quoi tient cette rupture dans le processus d’assimilation ?
Philippe d’Iribarne : La crise économique a joué un rôle important, bien sûr. Elle a limité les possibilités d’emploi et accentué les phénomènes de ghettoïsation. Les discriminations à l’embauche, courantes dans l’Hexagone – pour obtenir un entretien, mieux vaut s’appeler Sébastien que Mohammed – ont joué également. Mais tout cela ne suffit pas, loin s’en faut, à expliquer les difficultés d’intégration de la deuxième génération d’immigrés d’Afrique du nord. A mon sens, celles-ci tiennent au moins autant à un problème d’assimilation des codes qui régissent le fonctionnement de la société française. Traditionnellement, les familles maghrébines étaient régies par un modèle autoritaire : les filles sont bouclées et, tout en étant choyés par leur mère, les garçons obéissent à leur père. Mais, dans la France des années 1970, les enfants se sont rebellés. Ils ont mis en avant la liberté dont jouissaient leurs camarades d’école. Et comme leurs pères étaient souvent tombés dans le chômage, ils n’avaient plus la légitimité pour s’imposer.
Capital : Bien des familles françaises ont été confrontées au même défi après mai 1968 !
Philippe d’Iribarne : Oui. Mais dans beaucoup d’entre elles, l’autorité était moins marquée. Et, quoi qu’on en dise, on avait l’habitude d’expliquer, de justifier, de négocier. Si bien que le passage à une éducation plus permissive a pu se faire relativement en douceur. Dans les foyers maghrébins, par contre, où aucune tradition de discussion ne prévalait, et où la barrière de la langue (les enfants parlent mal l’arabe ou pas du tout, et les parents très mal le français) a rendu difficile toute forme de dialogue un peu subtil, le modèle a explosé. Du coup, beaucoup de jeunes se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, privés d’encadrement familial, n’ayant intégré ni les formes de socialisation qui prédominent dans les pays d’origine de leurs parents, ni celles qui marquent la société française. Comme personne ne les poussait à travailler, ils ont accumulé de médiocres résultats scolaires et sont sortis de l’école sans aucune qualification.
Capital : Vous voulez dire qu’ils étaient pratiquement condamnés au chômage ?
Philippe d’Iribarne : Pas forcément. Dans les années 1980, il y avait encore beaucoup de postes ouverts aux non-qualifiés. Mais ces jeunes n’étaient pas préparés à les occuper. On ne s’en rend pas toujours compte, mais il existe un formidable hiatus entre le «savoir-être» qu’on exige dans les entreprises et les comportements peu disciplinés qui se sont répandus à l’école, avec la permissivité qui s’y est développée. Or un grand nombre des enfants d’immigrés d’Afrique du nord ne peut guère compter sur l’éducation familiale pour combler ce hiatus. J’ai recueilli sur ce point les doléances d’agents de maîtrise d’usines automobiles : avec les pères, les choses se passaient bien, ils travaillaient dur et cherchaient à s’intégrer. C’est quand les fils se sont présentés que les problèmes ont surgi. Pour eux, il n’était pas question de se faire «esclavagiser» par des «petits chefs» issus, de surcroît, d’un pays colonisateur !
Capital : Ils ne voulaient pas subir les humiliations qu’on avait infligées à leurs pères ?
Philippe d’Iribarne : En effet. Beaucoup ont claqué la porte au bout de quelques jours, jugeant plus digne de vivre du RSA et de petits trafics que d’un emploi dévalorisé à leurs yeux. Ce genre de réaction est très rare chez les immigrés asiatiques: eux sont prêts à accepter sans broncher les tâches les plus ingrates, du moment qu’ils ont l’espoir de gravir l’échelle sociale. Mais dans les cultures arabes, le sens de l’honneur rend difficile d’accepter ce genre de compromis. Comme le dit Henry Laurens, alors que l’Extrême-Orient vit ses rapports à l’occident sur le mode de la revanche, le Moyen-Orient les vit sur le mode du ressentiment. Ce n’est pas du tout la même chose.
Capital : Pourquoi les pères ont-ils accepté hier ce que leurs enfants refusent aujourd’hui?
Philippe d’Iribarne : Parce que eux avaient grandi au pays! Leur référence n’était donc pas les emplois en France, mais les emplois dans leur région d’origine.
Capital : Le retour à l’islam nuit-il à l’insertion économique des immigrés de deuxième et de troisième génération ?
Philippe d’Iribarne : Il est évident que cela ne leur facilite pas la tâche. Lorsqu’une femme se rend aux entretiens d’embauche avec un voile, elle diminue ses chances d’être engagée. Ce n’est pas du racisme de la part des entreprises. Elles veulent juste éviter d’être confrontées à l’immixtion du fait religieux dans leurs murs, avec ce que cela suppose de contraintes et de conflits potentiels. Aujourd’hui, la loi ne leur permet pas d’interdire les signes religieux dans leur règlement intérieur, au motif que cela porterait atteinte à la liberté de conscience. Il y a là pour les entreprises une source d’insécurité qui se retourne contre les populations que la loi prétend défendre. Si une telle disposition pouvait être introduite, les employeurs seraient sans doute beaucoup moins frileux pour l’embauche de candidats qui apparaissent, à tort ou à raison, comme musulmans.
Capital : La culture arabo-musulmane valorise-t-elle suffisamment le travail ?
Philippe d’Iribarne : Ce n’est pas la question. Dans les entreprises que j’ai étudiées au Maroc ou en Jordanie, les gens triment dur. Je n’ai jamais entendu les directions des groupes qui ont des filiales de l’autre côté de la Méditerranée se plaindre de l’engagement des salariés. Ce ne sont pas des Chinois, certes, mais nous non plus !
Propos recueillis par Philippe Eliakim
Philippe d’Iribarne est anthropologue. Il est l’auteur des «Immigrés de la République» (le seuil) et de « L’islam devant la démocratie» (Gallimard).









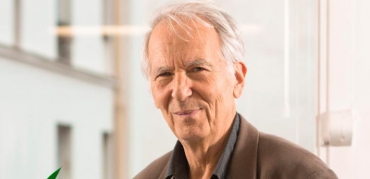
Les commentaires sont fermés.